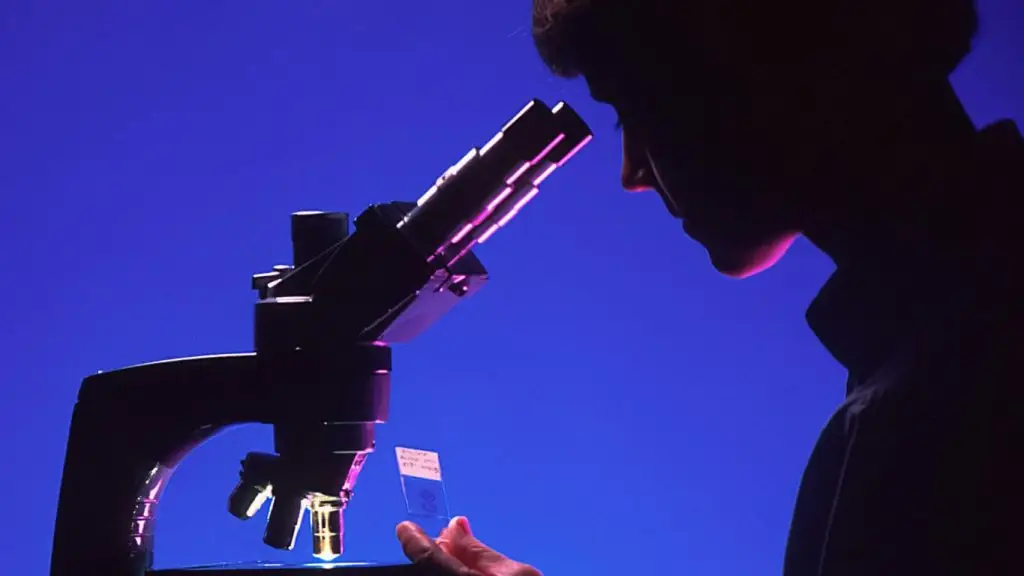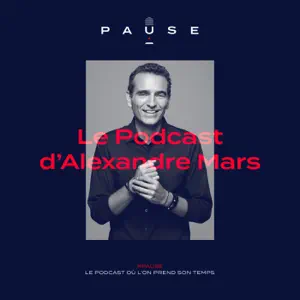La parité dans le monde scientifique peine encore aujourd’hui à s’affirmer. Seulement 29 % des chercheurs scientifiques sont des femmes, d’après un rapport du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publié en 2021. Cet écart ne date pas d’hier. Et de fait, jusqu’à la fin du XIXe siècle, les études supérieures scientifiques étaient interdites aux femmes en France. Aussi, l’accès aux grandes écoles comme l’École polytechnique leur était proscrit jusqu’en 1972. En bref, historiquement, les femmes n’avaient pas leur place dans cet univers et se sont longtemps vu spolier leurs travaux, dès lors qu’elles tentaient d’apporter leur contribution.

Alors, pour inciter les femmes à se positionner dans ce milieu avec confiance et sans vergogne, Emmanuelle Laroque a écrit “Tu seras scientifique, ma fille”. Cet ouvrage, publié aux éditions Vuibert, a un objectif simple : inciter les jeunes femmes à faire des sciences. “Il faut bien comprendre que les filles, [dès leur plus jeune âge] ne voient pas de femmes dans les sciences et sont comparées aux garçons sur leurs compétences en mathématiques. Elles vont donc cultiver l’idée qu’elles vont être moins bonnes que les garçons”, explique l’autrice.
Alors, inciter les filles à se diriger vers les sciences passe, selon elle, par l’éducation. “On peut reprendre [ces stéréotypes] et les déconstruire, et montrer à chaque fois qu’une fille, quel que soit son âge, fait quelque chose qui relève d’une compétence scientifique, […] qu’elles ont les facultés, les capacités et qu’elles peuvent les développer. Ça, c’est très important.”
L’Effet Matilda : minimiser les travaux des femmes scientifiques
Pensé comme un guide pratique, l’ouvrage d’Emmanuelle Laroque commence par un voyage dans le temps. L’idée est alors de prouver que des femmes scientifiques, il y en a eu, mais qu’elles ont, pour la plupart, été invisibilisées, voire volontairement oubliées. Il s’agit là de l’Effet Matilda. C’est l’historienne Margaret W. Rossiter qui a souhaité baptiser ce phénomène, décrit pour la première fois, en 1870, par la suffragette et abolitionniste Matilda Joslyn Gage. “Il se manifeste de diverses manières. Par l’attribution du crédit des découvertes scientifiques faites par des femmes à leurs collègues masculins, d’une part. Mais aussi par la sous-représentation des femmes dans les postes de direction ou dans les prix et distinctions prestigieux”, résume l’ouvrage d’Emmanuelle Laroque.
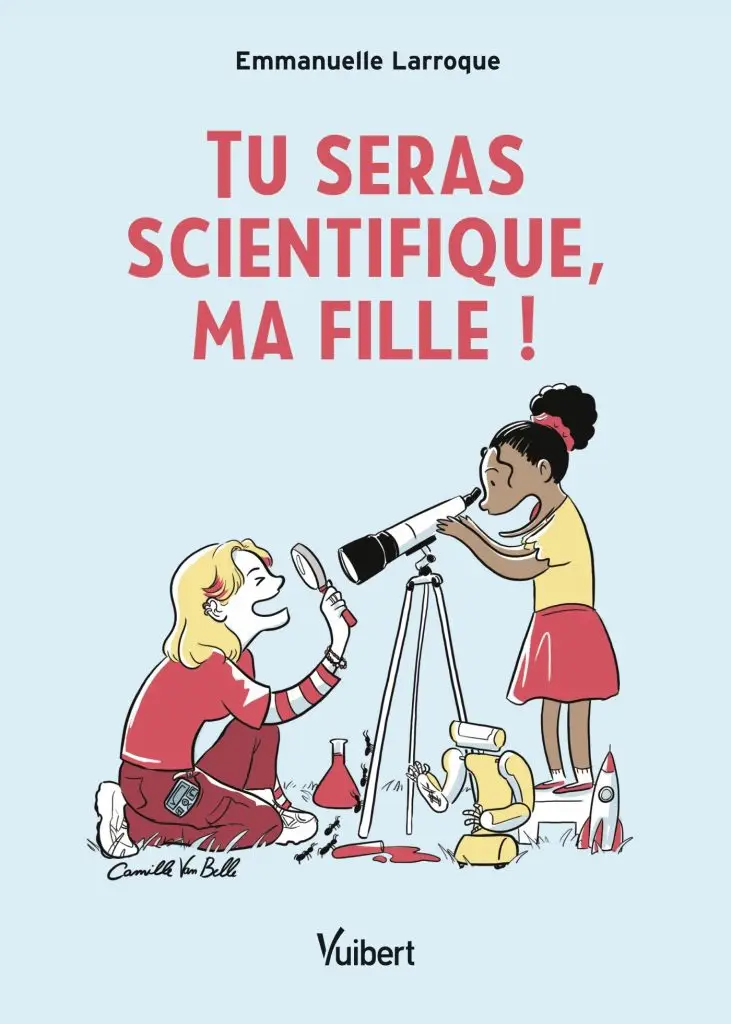
Alors, pour attester leur contribution au monde scientifique, l’autrice énumère quelques-unes des scientifiques refoulées. Parmi elles, Lise Meitner qui, en 1938, a joué un rôle crucial dans la découverte de la fission nucléaire. En collaboration avec Otto Hahn, elle a jeté les bases théoriques de la réaction en chaîne nucléaire. Malgré son important travail, lorsque Otto Hahn a reçu le prix Nobel pour cette découverte, il n’a parlé ni d’elle, ni de ses travaux. Aujourd’hui encore, sur le site du prix Nobel, il n’existe aucune mention la concernant. Lise Meitner a par ailleurs été l’une des seules scientifiques à contester l’utilisation de sa découverte dans la contribution de la bombe nucléaire.
Cette aversion envers les femmes scientifiques ne concerne malheureusement pas uniquement Lise Meitner. Si l’héritage de ces découvertes a été réhabilité pour certaines, elles apparaissent encore rarement dans les manuels scolaires ou dans la culture populaire.