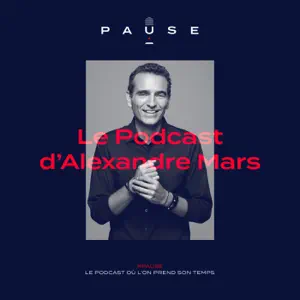Selon René Baldy, les dessins des enfants ne sont pas de simples représentations graphiques. Ils traduisent une évolution progressive des capacités motrices, cognitives et sociales de l’enfant. Le jeune dessinateur débute avec le gribouillage, une étape essentielle, souvent amorcée vers l’âge d’un an et demi. « L’enfant qui gribouille n’a pas d’intention figurative », explique René Baldy. Ce stade marque cependant une double découverte : le plaisir moteur du geste et celui de constater que ce geste laisse une trace visible.
Avec le temps, les tracés deviennent plus réguliers et contrôlés. « En ralentissant son geste, l’enfant parvient à produire des formes plus précises, comme un cercle ou une ligne droite. À partir de là, il peut structurer ces éléments pour représenter le monde », précise l’expert. Vers 3 ou 4 ans, l’enfant commence à réaliser des dessins figuratifs, où le spectateur peut reconnaître des objets ou des personnages.
L’importance des symboles dans les dessins des enfants
Malgré une éducation qui tend à gommer les stéréotypes, les filles dessinent souvent des femmes en robe, tandis que les garçons dessinent des hommes en pantalon.
Cette influence provient notamment des livres illustrés, où les personnages féminins portent fréquemment des robes. Mais ce choix est aussi pratique : « Dessiner une robe est un moyen efficace pour différencier un personnage féminin d’un personnage masculin, comme l’anse différencie une tasse d’un bol. » Ainsi, l’enfant simplifie le monde pour le rendre compréhensible et accessible à travers le dessin.
Quand et pourquoi les enfants arrêtent de dessiner
Souvent, l’enfant abandonne progressivement le dessin vers l’âge de 10 ou 11 ans. René Baldy identifie trois causes principales. D’une part, l’évolution cognitive joue un rôle clé : « La pensée de l’enfant devient plus abstraite et il s’intéresse davantage aux idées qu’aux formes visuelles. »
D’autre part, les pressions sociales et scolaires interviennent. Le dessin, valorisé dans la petite enfance, est perçu comme une activité futile à l’adolescence, au profit des devoirs et des performances académiques.
Enfin, il y a des raisons techniques : les enfants peinent à répondre à leurs propres exigences esthétiques. « La difficulté de maîtriser la perspective peut les décourager », souligne René Baldy.
L’usage des couleurs dans les dessins des enfants
« Les jeunes enfants utilisent rarement la couleur de manière réaliste », remarque René Baldy. Le tronc d’un arbre peut être rose, tandis qu’un soleil devient vert. Ce choix se fait souvent pour des raisons esthétiques, et non pour imiter la réalité.
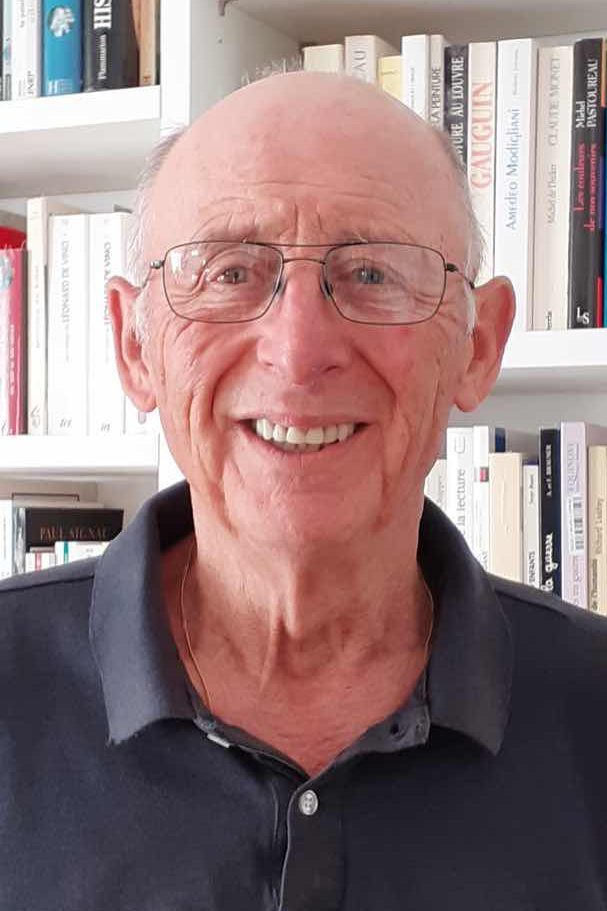
Cependant, dès 7 ou 8 ans, l’usage des couleurs se conforme davantage aux conventions culturelles. « Les enfants apprennent que le feuillage est vert, le ciel est bleu et le soleil jaune, même si ces associations ne reflètent pas toujours la réalité », explique-t-il. Ces conventions sont transmises par les modèles visuels qui entourent l’enfant, qu’il s’agisse de livres, d’enseignants ou d’autres enfants.
L’invité.
René Baldy est professeur honoraire de psychologie du développement de l’enfant. Il a fait toute sa carrière à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Il étudie le développement psychologique de l’enfant à partir de l’évolution de ses dessins. Il a écrit de nombreux articles ainsi que plusieurs ouvrages sur le sujet. Conseiller scientifique auprès de l’IMAJ (Institut Mondial de l’Art pour la Jeunesse), « graines d’artistes », équipe Aurélien Bénel, Université de Troyes. Parrain du MUZ, le musée des œuvres des enfants créé par Claude Ponti.